Un chemin de Vie
Le 17 mars dernier, mon ami Driss Alaoui M’Daghri s’est rendu à Nice à l’invitation de Tedx Nice, dont l’objectif est de diffuser les idées créatrices à travers le monde. Il nous livre les leçons de son expérience…

Dans ce magnifique décor du Centre Universitaire Méditerranéen, qui semblait avoir été installé pour lui par Paul Valery en 1933, Driss Alaoui avait affaire à de jeunes étudiants et créateurs qui attendaient de lui qu’il leur trace son « Chemin de Vie » comme on trace une piste, alors qu'ils se trouvent à ce moment crucial de leur vie où il s'agit de faire les premiers pas pour pénétrer dans cette jungle barbare et inextricable du monde mondialisant.
Il a commencé son exposé, comme on aurait pu ne pas s‘y attendre, par la perplexité:
Au commencement de tout, à la base de tout savoir, notre perplexité fait face aux énigmes du monde. Ces réflexions, forcément lapidaires, visent à partager quelques éléments d’expérience tirées du chemin de vie qui m’a amené à faire le parcours que j’ai fait et là où je suis, c’est-à-dire là où je me déclare volontiers « réfugié poétique ». Car parler de soi n’a d’intérêt que dans la mesure où cela nous éclaire à travers le singulier d’une vie, sur ce que l’on découvre d’universel dans chaque vie.
La distance, voire une certaine ironie par rapport aux choses, le plaisir de faire des choses simples, le partage et la rencontre avec les autres - indépendamment de leur origine, de leur race ou de leur religion - le sentiment que les choses ont un sens parce que fondées sur des valeurs universelles - sans renoncement à notre identité locale et à notre identité personnelle, la création et le rêve, c’est cela qui constitue mon chemin de vie.
Ce chemin a été ponctué par la diversité des expériences, l’intensité du vécu, la fécondité des rencontres et des échanges qui ont représenté, chaque fois, une opportunité exceptionnelle pour aller de l’avant, créer du lien et approfondir la connaissance de moi-même et des autres.
Je veux, ici, parodier Borges en disant « Toi, qui écoute, es–tu sûr de comprendre ma langue ? ». À quoi suis-je tenté d'ajouter « Toi qui parles, es-tu sûr de comprendre ta propre langue ? ».
Au commencement, un « ? ».
Car Dieu peut commencer par une injonction (Que la lumière soit !), mais nous autres pauvres humains, nous nous trouvons d’emblée face à des questions auxquelles il n’y a pas de réponse évidente. Je crois que c’est peut être d’avoir eu constamment chevillé au corps ce questionnement permanent face aux choses de la vie qui m'a permis de réaliser le parcours que j’ai fait.
Cette interrogation peut être vue sous deux aspects : pourquoi les choses sont-elles comme elles sont? Que faire?
Les interrogations ont commencé à m’assaillir dès ma plus tendre enfance. Je ne vous raconterai pas la scène avec les trois petites filles qui me mettaient face à la question épineuse de les départager à propos de leur anatomie dans la rue de la médina de Fès où je suis né, vous lirez cela dans un essai autobiographique, à paraitre. Plus tard, en 1971, à l’âge de 27 ans, plein de jeunesse et d’ambition, je me retrouve au Palais de Skhirat en pleine tentative de coup d’État contre le Roi Hassan II, une tentative qui se termine dans un bain de sang, tandis que je m’enfuyais par la plage avec encore dans mes oreilles le bruit des balles qui sifflent.
C’est alors que l’on pouvait s’interroger, en se demandant si le pays n’avait pas fait complètement fausse route. Est-ce sa gouvernance qui avait conduit à cette situation ou est-ce que des mouvements de fond à l’œuvre à l’extérieur du pays ne se conjuguaient pas avec de gigantesques problèmes politiques et sociaux à l’intérieur pour l’expliquer ? Et que faire ?
Comme l’Algérie voisine passait pour la Mecque du Tiers Monde, je me suis mis en tête d’aller voir cette expérience de près. Peut-être que le modèle algérien était la bonne réponse. Je n’ai pas mis longtemps à m’apercevoir que les militaires ajoutés au parti unique, à la bureaucratie et à la gestion socialiste des entreprises n’étaient pas vraiment la bonne méthode.
Oui, l’interrogation toujours, mais sont tout aussi importants la surprise, l’étonnement…
À bout touchant
Au moment où j'écris ce blog, Mohammed Merah, un homme âgé de 24 ans, est actuellement cerné par la police. Il est quasiment identifié comme étant l’assassin de trois militaires, puis de trois enfants et d’un homme de 30 ans. Il a achevé ses victimes à bout touchant, son geste le plus horrible ayant consisté à attraper une petite fille par les cheveux pour l’abattre d’un coup de pistolet.
 Je laisse de côté la question des origines ou des « motivations » de cet homme. Elles seront largement traitées par les medias. Faussement, on dira que c’est un monstre, c’est-à-dire un être avec lequel nous n’avons rien en commun. Malheureusement, c’est faux. C’est ce point en particulier que je veux traiter dans ce blog. Nous disons cela pour nous rassurer, pour nous convaincre que nous, nos pareils, nous ne feront rien de tel.
Je laisse de côté la question des origines ou des « motivations » de cet homme. Elles seront largement traitées par les medias. Faussement, on dira que c’est un monstre, c’est-à-dire un être avec lequel nous n’avons rien en commun. Malheureusement, c’est faux. C’est ce point en particulier que je veux traiter dans ce blog. Nous disons cela pour nous rassurer, pour nous convaincre que nous, nos pareils, nous ne feront rien de tel.
Sans doute, nous ne le ferons jamais, mais nous le pourrions: l’histoire, l’actualité, les faits divers nous le montrent. L’être humain est d’une violence et d’une cruauté inouïe. Il le montre à chaque instant avec les animaux et avec ses semblables chaque fois que l’occasion lui en est offerte. Il le montre à Toulouse, à Oslo, à Syrte, dans les écoles américaines, en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie, au Zaïre. Il l’a montré partout, au Zimbabwe, au Cambodge, en Algérie dans les décennies passées. La guerre de 1940-1945 a étalé ses horreurs dans les camps de concentration nazis, l’URSS et la Chine ont assassiné des millions d’être humains avec un détachement qui n’est que trop humain, la guerre d’Espagne a révélé au monde à quel point la haine de l’autre pouvait générer de cruauté.
Si les conditions sont réunies, il n’y a pas d’être plus cruel que l’homme. Puisque nous avons la chance, ou la malchance, d’en être conscient, tâchons de ne pas l’oublier.
Deux votations suisses
Tout le monde a appris, avec surprise, admiration ou regret, qu’une majorité importante de votants suisses (66,5%) a rejeté une requête portée par le syndicat Travail Suisse, visant à allonger la durée légale des congés payés de quatre à six semaines par an.
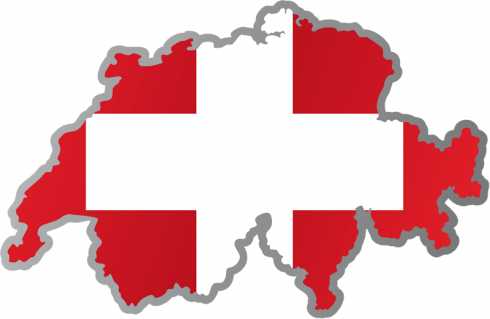 Aucun canton de la confédération n’a donné une majorité au «oui», même si les Suisses romands limitrophes de la France (Jura), ou de l’Italie (Tessin) n’en étaient pas loin. Les Suisses alémaniques, en revanche, ont été jusqu’à 82,1% (dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures) à voter «non» aux congés supplémentaires. L’organisation patronale « Économie Suisse » s’est réjouie, hier, de «ce vote clair en faveur de la place économique suisse». Son argumentaire, auquel les citoyens ont souscrit, est que «l’initiative aurait eu des conséquences négatives sur la compétitivité». Économie Suisse estime que « les sous-traitants, ainsi que les petites et moyennes entreprises comptant moins de 250 employés auraient été touchés durement », d’autant plus que la Suisse souffre de freins à la compétitivité, comme le franc fort, les coûts de la main-d’œuvre très élevés, et rappelle le contexte actuel de crise.
Aucun canton de la confédération n’a donné une majorité au «oui», même si les Suisses romands limitrophes de la France (Jura), ou de l’Italie (Tessin) n’en étaient pas loin. Les Suisses alémaniques, en revanche, ont été jusqu’à 82,1% (dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures) à voter «non» aux congés supplémentaires. L’organisation patronale « Économie Suisse » s’est réjouie, hier, de «ce vote clair en faveur de la place économique suisse». Son argumentaire, auquel les citoyens ont souscrit, est que «l’initiative aurait eu des conséquences négatives sur la compétitivité». Économie Suisse estime que « les sous-traitants, ainsi que les petites et moyennes entreprises comptant moins de 250 employés auraient été touchés durement », d’autant plus que la Suisse souffre de freins à la compétitivité, comme le franc fort, les coûts de la main-d’œuvre très élevés, et rappelle le contexte actuel de crise.
Le président du groupe des Verts en Suisse, le conseiller régional Antonio Hodgers, dans un entretien au quotidien La Tribune de Genève, observe que «la peur a gagné. Les gens sont préoccupés par leur travail et leurs revenus. Dans ce contexte de crainte, une majorité de Suisses n’a pas voulu donner un signal négatif en partant en vacances de manière insouciante » et la députée socialiste (canton de Vaud) Josiane Aubert a dénoncé les adversaires de la proposition en affirmant qu' « ils avaient peint le diable sur la muraille et mené une campagne massive ».
Ce résultat ressemble à celui obtenu par l'initiative sur les 36 heures de travail hebdomadaire, refusée dix ans auparavant par 74,6 % de la population et tous les cantons ».
L'Union patronale suisse (UPS) observe de son côté que « cette initiative entraînerait effectivement des charges supplémentaires de 6 milliards de francs suisses pour les entreprises ». Pour le directeur d'Economie Suisse, Pascal Gentinetta, les Suisses ont bien compris que la crise de l'endettement en Europe et le défi de la compétitivité lié au franc fort « font que la Suisse ne peut pas se permettre une telle mesure ». De fait, la productivité a augmenté de 20 % en Suisse au cours des dernières années.
On peut invoquer que la culture suisse, enracinée dans le calvinisme, confère au travail confère non seulement un salaire, la sécurité et l’intégration sociale, mais permet aussi de se sentir utile.
En France, Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à la présidentielle, a déclaré qu’il plaignait les Suisses de tout son cœur qui se laissent « intimider par un patronat qui les convainc de ne pas prendre de vacances.»
Mais les Suisses n’ont pas voté que sur le temps de travail dimanche dernier. Lors des votations de dimanche dernier, les Suisses ont aussi décidé de limiter le nombre de résidences secondaires dans leurs communes. Le résultat de l'initiative a surpris tout le monde, car la proposition de plafonner les maisons de vacances à 20% du parc seulement par village était assez osée. Elle a été approuvée de justesse, avec 50.6% des voix.
Le but de ce texte novateur est de diminuer le nombre de lits froids, augmenter les habitants des villages, freiner la spéculation immobilière et baisser les prix des logements. Les stations de montagne du Valais, un canton très touristique, sont directement visées par l'initiative. Pour les entrepreneurs, c'est la croissance économique de la région qui va en pâtir. Pour leurs opposants, il s'agit au contraire d'une belle opportunité pour préserver l'environnement local, attirer plus de touristes et rafraîchir l'offre d'hôtels sur place, parfois vieillissants.
Moralité, les Suisses, comme les Belges, restent différents des Français. Cette belle découverte est réjouissante : la diversité culturelle n’est pas morte, dans le cadre d’une mondialisation qui, souvent, la nie.
Au son de la cloche des Cordeliers
Dans la longue série d’articles que j’ai entrepris de publier sur les agissements et les résultats du pouvoir politique français, pouvoir centralisé, pouvoir fondé sur le caractère sacré de son origine, tout d’abord supposé divin puis présumé fondé sur les Droits de l’Homme, il faut que vous reveniez au blog du 28 novembre 2011 pour trouver l’antécédent de ce blog.
J’y présentais la première constitution française, constitution royale, constitution démocratique, sans doute trop démocratique pour les forces politiques à l’œuvre en 1791 puisqu’elle vécut moins d’un an.
 Dés que la Constitution fut mise en œuvre en octobre 1791, une fois les députés élus, il fut tout de suite patent que le couple formé par l’Assemblée législative et le roi Louis XVI fonctionnait mal. L’Assemblée rêvait d’un roi constitutionnel qui accepterait volontiers l’amputation permanente de son pouvoir. Or, Louis XVI s’y refusait depuis le début de la Révolution, exactement depuis le 9 juillet 1789, date à laquelle les Ètats Généraux s’étaient déclarés Assemblée Constituante.
Dés que la Constitution fut mise en œuvre en octobre 1791, une fois les députés élus, il fut tout de suite patent que le couple formé par l’Assemblée législative et le roi Louis XVI fonctionnait mal. L’Assemblée rêvait d’un roi constitutionnel qui accepterait volontiers l’amputation permanente de son pouvoir. Or, Louis XVI s’y refusait depuis le début de la Révolution, exactement depuis le 9 juillet 1789, date à laquelle les Ètats Généraux s’étaient déclarés Assemblée Constituante.
Contraint par la rue et l’Assemblée, ramené de force aux Tuileries après la fuite à Varennes, il faisait constamment de la résistance. Puisque la Constitution lui avait octroyé un droit de veto, il se mit tout de suite à en user largement. Il se mit à renvoyer les ministres, pendant que l’Assemblée de son côté prenait constamment des mesures contre le clergé ou les immigrés, poussée qu’elle était à la surenchère par la pression qu’exerçait sur elle une foule parisienne manipulée par des agitateurs.
C’est ainsi que l’Assemblée prit l’initiative, invoquant l’appui que l’empereur Léopold II apportait aux immigrés, de déclarer le 20 avril 1792 la guerre au « roi de Bohême et de Hongrie », ouvrant vingt-trois années de guerres européennes presque ininterrompues. Dès lors, la tension ne cessa de croître entre le roi qui s’opposait aux décrets sur la déportation des prêtres réfractaires et les militants des faubourgs parisiens, conduits notamment par le riche brasseur Santerre, celui-là même qui mènera le 10 août 1792 l’assaut contre les Tuileries. Ces militants envahirent donc une première fois les Tuileries pour lui demander de retirer son veto. Ce roi réputé faible ne céda pas, pas plus que l’Assemblée. Une pétition circula le lendemain pour demander la punition des émeutiers tandis que le Roi publiait une proclamation pour condamner cette intrusion et passait fermement en revue un bataillon de la garde nationale.
Après ce grave incident, l’Assemblée fut accablée par les membres du Club des Jacobins de demandes de déchéance du Roi auxquelles elle avait de plus en plus de mal à résister.
Le pouvoir était à prendre.
Il fut pris.
Lorsque la cloche des Cordeliers se mit à carillonner, à minuit moins le quart le 9 août 1792, pour donner le signal aux sections de la Commune insurrectionnelle pilotée par Danton de l’occupation de l’Hôtel de Ville, nul ne savait encore qu’elle sonnait le glas d’un millénaire de royauté. Nul ne se doutait non plus que les nouveaux dirigeants, qui allaient s’emparer facilement par la force des commandes de l’État le 10 aout 1792, allaient déchainer pendant les deux années suivantes la tempête politique la plus violente qu’ait jamais connu la France dans toute son histoire, sous le nom tout à fait approprié de Terreur.
Comment s’étaient organisés ces hommes ? Députés, avocats, comploteurs aguerris, ils avaient formé hors de l’Assemblée un comité destiné à préparer une insurrection. Cette dernière commença par la prise de l’Hôtel de Ville de Paris.
Le bâtiment occupé, ils y convoquent le chef de la garde nationale, le marquis de Mandat, qu’ils abattent immédiatement afin de désorganiser la garde. Puis ils marchent sur les Tuileries, protégées par les gardes suisses et les gardes nationaux. Ces derniers, désorientés par la mort de leur chef, font en partie défection. Le roi, avec sa famille, cherche alors refuge à l'Assemblée.
Au matin du 10 août, le jardin des Tuileries est investi, les Suisses barricadés dans le palais déclenchent une fusillade qui met hors de combat une centaine d'assaillants, mais ils restent encerclés par les émeutiers du faubourg Saint-Antoine. C’est alors que le Roi, sur l’insistance des députés, signe un billet donnant l'ordre aux Suisses d'arrêter le combat et de se rendre. Mal leur en prit d’obeir, puisqu’ils furent presque tous, huit cent personnes au total, massacrés par les émeutiers qui en profitèrent pour piller les Tuileries.
Le Roi et sa famille se retrouvent alors sans protection, autre que celle des députés qui les entourent. Ils sont à la merci des émeutiers qui, après les Tuileries, envahissent les bâtiments de l’Assemblée et contraignent les députés qui n’avaient pas encore fui à prononcer la suspension du Roi et à mettre fin immédiatement au mandat de l’Assemblée qui courait jusqu’au 30 septembre 1793. Les comploteurs ont en effet décidé que l’Assemblée serait remplacée par une Convention dont le but affiché serait d’élaborer une nouvelle constitution.
Quant à Louis XVI et sa famille, ils furent faits prisonniers par la commune insurrectionnelle de Paris.
Le royaume de France, sa constitution et la légalité avaient vécu.
Le point de vue grec en 2022?
Ce blog est issu d’une interview donnée le 19 février dernier au journal Libération par Roberto Lavagna, ancien ministre de l’économie du gouvernement argentin. Il poursuit notre réflexion sur la crise grecque.

On peut comparer à plusieurs égards la crise argentine de 2001-2002 et la crise grecque. L'Argentine avait établi une parité fixe entre le peso et le dollar, perdant ainsi le contrôle sur sa monnaie comme c’est le cas de la Grèce avec l'euro. Il en résultait que l’Argentine était liée par un taux de change fixe avec les Etats-Unis alors que sa compétitivité sur le marché mondial était beaucoup faible, comme la Gréce par rapport à l’Allemagne. En 2002, l'Argentine était en recession depuis quatre ans, comme la Grece exactement dix ans plus tard, avec un gigantesque déficit fiscal, un lourd déficit des comptes courants, une chute vertigineuse du PIB, un endettement énorme et l'explosion du chômage. Donnée agravante par rapport à la Grèce d’aujourd’hui, sa situation sociale était bien pire et, malchance ou chance, l'Argentine était un pays isolé alors que la Grèce fait partie de l'Union Européenne.
Depuis le début de la crise, en 1998, l’Argentine avait bénificié de deux programmes du FMI pour un total de 51 milliards de dollars. Les deux avaient échoués et une demande supplémentaire de rallonge de crédit de 17 milliards de dollars était en cours. C’est alors, en avril 2002, que l’Argentine a décidé de renoncer à ces crédits en s’engageant à payer les intérêts de la dette déjà due et une partie du capital, tout en demandant un roll over partiel de ses écheances. Elle a alors mis fin au soutien qu’elle accordait aux banques, soutien qui était l’une des conditions éxigées par le FMI pour accorder un nouveau prêt.
Il faut observer ici que le FMI offre toujours le même prêt à porter pour ses contrats d'ajustement, qui consiste à diminuer les prestations publiques, les salaires, les pensions, les aides et même les travaux publics, pour consacrer l'argent économisé à payer les créanciers. Tout se passe comme si l’objectif principal du FMI consistait à protéger en priorité les prêteurs, le redressement économique du pays endetté étant pour lui un objectif secondaire. Il ne se demande pas si la Grèce ne devrait pas plutôt investir dans l'éducation, les sciences et la technologie, financer des infrastructures et accroitre sa productivité, plutôt que de réduire les salaires et les retraites afin de rembourser en priorité ses créanciers.
C’est que l’on oublie, lorsque l’on suit aveuglément les recommandations des banquiers, que leur business consiste à vendre de l’argent. C’est pourquoi ils frappaient déja à la porte de l’Argentine en 2005, deux jours après l’achévement de la restructuration de sa dette. En vain. Car cette dernière se refuse à emprunter avant 2014, date à laquelle sa dette ne représentera plus que 30% du PIB, la moitié seulement de ce qu’exigent les critères de Maastricht. L’Argentine estime désormais qu’il vaut mieux que son budget ne dépende pas trop des banques qui travaillent sur le marché international.
On est loin de la Grèce de 2012 mais peut-être assez proche de la Gréce de 2012 : une fois qu’elle sera sortie de la crise, le gouvernement grec y regardera à deux fois avant de revenir solliciter « l’aide » des banques sur le marché financier mondial.

/image%2F1212829%2F20200120%2Fob_e11547_vieme.png)


